Un concept à la loupe.
« Les femmes sont plus douces, plus attentives aux autres… Mais qu’est-ce qu’elles sont bavardes. C’est une histoire d’instinct maternel et de cerveau gauche, ça ! », « Les hommes sont des conquérants… Mais ne savent pas faire plusieurs choses à la fois. Que voulez-vous, la téstostérone et le cerveau droit, on ne se refait pas… » Quand on parle de stéréotypes, un mot revient souvent dans les discours : essentialisme.
Mais c’est quoi exactement ? D’où vient cette notion que l’on apparente ou oppose fréquemment à d’autres, pas moins conceptuelles (le nominalisme ou le ségrégationnisme d’une part, le constructionnisme ou l’universalisme de l’autre, et au milieu le déterminisme) ? Pour y voir plus clair, le blog EVE passe le concept à la loupe.
Aux origines du mot, Karl Popper. Aux origines de l’idée, Platon ?
L’erreur originelle : avoir classifié les humains, au lieu de définir l’humain
C’est le philosophe des sciences Karl Popper qui introduit la notion d’essentialisme, dans son ouvrage Misère de l’historicisme, paru en 1945. Instruisant les paradigmes des sciences sociales alors en pleine expansion et qui se cherchent une méthodologie aussi légitime que celle des sciences dites dures, Popper traque les visions sanctuarisées, présupposés et autres prétendues évidences jamais remises en discussion.
Et ce que Popper commence par défier, c’est la définition de ce qu’humain est. Il fait remonter à l’Antiquité la définition admise de l’essence humaine, se penchant en particulier sur l’approche d’Aristote et de Platon : pour Popper, les premiers philosophes ont prétendu désigner l’essence de l’humain en construisant non pas une définition mais des typologies : une typologie qui opère un classement des espèces dans lequel l’humain s’insère (plutôt en haut de la hiérarchie tant qu’à faire) puis une typologie qui distingue des catégories au sein de l’espèce humaine (la plus connue chez Platon étant celle qui discerne les mâles, les femelles et les androgynes).
De la classification à la ségrégation : des risques de la perpétuation sans remise en question
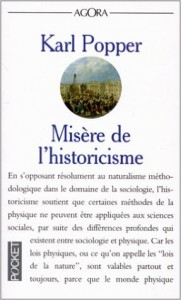 Voilà comme serait née, sur la base d’un processus de classification plus que de définition, une appréhension de l’essence humaine par catégories différenciées : une essence pour les hommes, une essence pour les femmes… Mais aussi par extension une essence pour les esclaves, pour les étrangers « barbares », pour quelque groupe dont il semble que ses membres ont plus en partage entre eux qu’avec le reste de l’humanité. Dans les pages les plus sombres de l’histoire (et parfois du temps présent), ces classifications essentielles vont servir de justification à des traitements inégaux et des séparations des mondes.
Voilà comme serait née, sur la base d’un processus de classification plus que de définition, une appréhension de l’essence humaine par catégories différenciées : une essence pour les hommes, une essence pour les femmes… Mais aussi par extension une essence pour les esclaves, pour les étrangers « barbares », pour quelque groupe dont il semble que ses membres ont plus en partage entre eux qu’avec le reste de l’humanité. Dans les pages les plus sombres de l’histoire (et parfois du temps présent), ces classifications essentielles vont servir de justification à des traitements inégaux et des séparations des mondes.
Ainsi, d’aucun-es attribueront les sources du ségrégationnisme et des principes de discrimination à Platon. Mais Popper n’effectue pas un tel raccourci : en adepte de la « quasi-erreur » qui doit autoriser le scientifique et le penseur à émettre des hypothèses qui s’avéreront éventuellement erronées mais permettent au travail de réflexion et au débat d’avoir lieu, il ne tient pas le philosophe antique pour responsable des dérives inspirées par sa pensée. C’est à ceux qui lui ont succédé qu’il reproche d’avoir accepté et perpétué le modèle platonicien de différenciation par l’essence sans jamais le remettre en question.
L’essentialisme avant la lettre : du « réalisme ontologique » au « déterminisme biologique», en passant par le « naturalisme » utilitariste
Le réalisme ontologique médiéval : premières tensions entre l’universel et le différentiel
Dietrich von FreibergEffectivement, le prémisse antique de différenciation des humain-es selon leur sexe, entre autres critères observables, va avoir de beaux jours devant lui.
Au Moyen-Âge, il prend la forme du « réalisme ontologique ». A la recherche de ce qui fait « l’être », le disciple d’Augustin Dietrich von Freiberg (XIIIè siècle) conforte l’idée que l’humain est un universel distinct de l’animal d’une part et de Dieu d’autre part ; mais qu’au sein de l’humanité, il faut bien se rendre à la « réaliste » évidence de dissemblances fondamentales : pas tant entre femmes et hommes (sujet qui l’intéresse peu) mais surtout entre peuples et civilisations.
La dialectique de l’universel et du différentiel est posée. Mais à l’avantage de qui cela va tourner ? Ceux qui déjà estiment que les différences entre humains s’imposent davantage que ce qu’ils ont en commun (et qui s’appuient sur l’observation de la réalité de proximité pour se donner raison), ou ceux qui bientôt arguent que la différence entre humains est annexe à la nature humaine universelle (et qui seront majoritairement renvoyés à une forme d’idéalisme qui ne résiste pas au réel) ?
Le temps de la « science naturelle » : le biologisme comme lecture indépassable du fait et de ses raisons
La balance penche nettement du côté des premiers, quand les sciences naturelles connaissent un formidable essor à partir de la Renaissance et jusqu’à nos jours.
On étudie le corps humain avec passion, mais avec quelques prismes aussi : comme le fait, par exemple, le pionnier des neurosciences Gustave Le Bon, étudiant le cerveau pour percer le mystère de la moindre intelligence des femmes ! Il le « prouve » : elles sont moins fute-fute que les hommes parce que la masse de leur cerveau est inférieure. Ni lui ni personne n’a démontré au préalable que les femmes étaient vraiment défaillantes dans les choses de l’intellect, ni même que l’intelligence se logeait dans la structure du cerveau. Mais en 1879, Le Bon est plus empreint de biologisme que de doute cartésien : il ne soupçonne pas l’hypothèse de l’infériorité des femmes de possible falsification et se dispense donc de l’interroger en tant que telle.
A la décharge de Le Bon et d’autres qui produiront des travaux qui nous paraissent a minima datés sinon complètement absurdes, voilà deux siècles que l’on nourrit la conviction que la biologie est en mesure de tout expliquer de la condition humaine. A mesure qu’on découvre le cerveau, les hormones, les gènes, on pense y trouver des facteurs déterminants des qualités et des comportements : on cherchera les gènes de l’intelligence, les hormones de l’empathie, l’ADN de la violence ou de la paresse et même la cellule de la jambe qui gigote ou la protéine du bavardage. Tout, tout, tout serait avant tout et malgré tout affaire de cerveau droit ou gauche, d’ADN, de physiologie, d’endocrinologie ou de métabolisme.
Le naturalisme : la nature n’a pas de Dieu, mais la science peut faire (à sa place) le job de dire la cause et la fin de chaque chose
Willard van Orman QuineLe naturalisme va encore enfoncer le clou en posant le principe que toute chose n’a de cause, d’explication et de fin que naturelle (et au passage que la question de ce qui est « nature » n’est que celle des scientifiques, personne d’autre n’étant qualifié pour exprimer son avis là-dessus, selon Willard van Orman Quine qui théorise le naturalisme).
Chez les penseurs de ce courant, la nature est plus forte que la volonté humaine de la dépasser ou de la contrer : même ultra-civilisé, l’humain resterait une créature mue malgré elle par des instincts et des comportements biologiquement cohérents (par exemple, on expliquera les tendances à l’endogamie ou au contraire au métissage par un processus de sélection des partenaires sexuels inconsciemment voué à assurer la survie de l’espèce).
Dans ce courant d’idées, la nature ne connait pas d’idéal, pas d’éthique ni de transcendance de quelque ordre que ce soit : elle est plutôt brutale, profondément inégalitaire, pas franchement tendre avec les faibles (les lectures rapides et contrefaites de Darwin sont aussi passées par là) voire parfois franchement cruelle.
Mais tout n’est pas perdu, du moins pour ceux qui ont des ressources, car si la nature ne peut pas être changée, elle peut être comprise. Par exemple, on considère que femmes et hommes sont différents et que de cette différence procède qu’ils sont inégaux, mais ils peuvent apprendre comment l’un et l’autre fonctionnent pour vivre en harmonie. Et ils y auraient tout intérêt : le biologisme rejoint alors l’utilitarisme quand prendre acte de ce qu’est la nature humaine (même si c’est peu flatteur, parfois) permet d’en tirer ensuite le meilleur profit. Pour illustration : l’individu privilégié n’a a priori pas intérêt à l’égalité, mais on peut tenter de le convaincre que celle-ci pourra malgré lui être rentable à moyen ou long terme, en le préservant par exemple, des conflits et manifestations de violence que de trop grands écarts de traitement pourraient entraîner (c’est un des arguments de Condorcet pour convaincre les hommes que la société a à gagner à l’égalité).
Nature contre culture, essentialisme contre existentialisme : « on ne nait rien, on devient tout » ?
L’existence précède l’essence : le « droit » à une destinée choisie
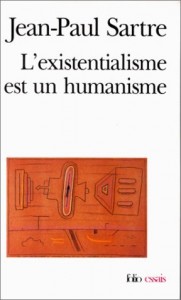 Sans surprise, l’existentialisme va radicalement s’inscrire en faux contre les formes de l’essentialisme.
Sans surprise, l’existentialisme va radicalement s’inscrire en faux contre les formes de l’essentialisme.
« L’existence précède l’essence » proclame un Sartre qui estime que l’être humain se définit par ses valeurs, ses actions et la maîtrise de son destin. Oui, l’observation de la réalité peut amener à conclure qu’il existe des différences incoercibles entre catégories d’humains et que l’on n’échappe pas au destin promis par son appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories. Sauf que ce déterminisme n’a rien à voir avec la nature (qui pousse l’humain à l’élan de liberté), mais devrait tout à la culture (qui emprisonne l’humain dans des loyautés obligées) : les différences seraient autant (et même davantage) construites que données.
Et cela de façon très insidieuse, par le truchement des structures mentales collectives qui nous « prophétisent » des destinées auxquelles nous préférons encore adhérer plutôt que nous perdre et nous épuiser en voulant y échapper, dit le sociologue des sciences Robert King Merton depuis son labo de Chicago.
Le Deuxième sexe : contre « les mythifications du féminin » qui échouent à « saisir l’essence » de « la » femme
 C’est évidemment Simone de Beauvoir qui décline ce logiciel à la condition des femmes, dans Le Deuxième Sexe. « On ne nait pas femme, on le devient« , la formule est célèbre.
C’est évidemment Simone de Beauvoir qui décline ce logiciel à la condition des femmes, dans Le Deuxième Sexe. « On ne nait pas femme, on le devient« , la formule est célèbre.
Beauvoir estime que l’humanité n’est pas qu’espèce (au sein du règne animal) mais aussi « civilisation », et elle rejette de ce fait l’idée que le pouvoir de gestation des femmes soit l’explication unique et ultime aux différences de traitement dont elles sont victimes. « L’essence » de « la » femme lui paraît irréductible à la seule maternité et au-delà de cela, parfaitement « insaisissable« .
C’est toute une « mythification » historique, religieuse et sociale du féminin qu’elle accuse d’interdire aux femmes de se vivre en êtres uniques, les forçant à se définir préalablement en tant que femmes, « relativement » aux hommes. En sous-jacemment, il y a toute une critique de l’idée de la « complémentarité » femmes/hommes qui assigne des rôles « utiles » à chaque sexe au prétexte d’une altérité dévoyée : pour Beauvoir, le rapport à l’autre est corrompu dès lors qu’il prend pour base l’acceptation d’une différence productrice d’inégalité.
Essentialisme et intersectionnalisme : les « appartenances multiples »
Quelle essence du stéréotype pour les poly-discriminé-es ?
La critique de l’essentialisme va trouver un souffle nouveau et gagner encore en complexité au début des années 1990, quand apparaît la notion d’intersectionnalité, sous la plume de l’universitaire Kimberlé Crenshaw.
Experte du « black feminism« , elle étudie le croisement des discriminations : quand être une femme noire homosexuelle, par exemple, expose simultanément au sexisme, au racisme et à l’homophobie. S’il y avait une « essence », laquelle serait-ce pour cette personne : son genre, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle, ou encore autre chose qui la caractérisent en conscience de soi (acceptée et/ou choisie) ou dans la perception que les autres ont d’elle (imposée) ?
Ce questionnement invite à penser la diversité des êtres à eux-mêmes en même temps que l’on pense la différence de traitement entre les individus ou les catégories d’individus.
L’inclusion du différent dans la considération de ses différences
Mais comment concilier cette vision qui atomise l’humanité en successions d’individus parfaitement singuliers (ce qui ferait de chaque individu une communauté à part entière) avec une perception sans déni des groupes discriminés (ce qui suppose la reconnaissance de l’existence de communautés, ne service que par le fait de discrimination dont elles font l’objet) ? En ne concevant pas les différences en terme d’essence mais d’appartenance choisie ou bien désignée, disent les penseurs de l’intersectionnalité.
Alors, ce qui se joue, c’est la possibilité d’appropriation (ou de distanciation) par chacun-e des éléments de son identité et l’inclusion des multi-appartenant-es que nous sommes toutes et tous. Nous avons toutes et tous des identités et loyautés plurielles, pour certaines données (comme le genre), pour d’autres héritées (un milieu social ou une origine géographique) ou bien transmises (une langue, une culture) ou encore adhésives (des valeurs personnelles acquises en dehors de l’influence familiale, des choix de vie autonomes…).
Tout ceci doit être considéré, non comme des marges à la « norme », mais comme des composantes à part entière de celle-ci. On pourrait le résumer ainsi : on ne définit plus la différence par rapport à ce qui fait « le même », mais on déconstruit « la norme du même » qui serait en fait celle du majoritaire et/ou du dominant.
Anti-essentialisme et égalité, des liens plus ambigus qu’il n’y parait
L’essentialisme : un solide fondement du sexisme
Avant d’entrer dans le débat « pour ou contre l’essentialisme », tentons une définition synthétique de la notion dans le contexte de l’égalité entre les sexes : l’essentialisme consiste à attribuer aux femmes et aux hommes des psychologies, des comportements, des caractéristiques sociales, des manières de voir différentes du fait de leurs différences biologiques observées et/ou scientifiquement avérées.
L’essentialisme est ainsi tenu par un grand nombre de promoteurs de l’égalité femmes/hommes comme le fondement du sexisme. Que celui-ci soit malveillant et misogyne (comme par exemple quand il attribue « un gène du commérage » aux femmes, ou suppose que les hommes sont inaptes à faire plusieurs choses à la fois) ou qu’il soit bienveillant et apparemment flatteur (comme par exemple, quand on espère des femmes en position de leadership qu’elles s’y montrent plus douces et conciliantes ou quand on métaphorise le courage au masculin par de valeureux attributs sis dans le slip !).
Le différentialisme : pour des droits spécifiquement féminins
Mais les rapports de l’essentialisme au combat pour l’égalité sont plus ambigus qu’il n’y paraît. Tout un courant dit « différentialiste », né en France et dans le monde anglo-saxon dans les années 1970 (représenté par Antoinette Fouque, Julia Kristeva ou Adrienne Rich) veut intégrer « l’essence de la féminité » dans les discours et actions en faveur des femmes.
Cette position va par exemple défendre l’idée d’un rapport privilégié qui unirait l’enfant à sa mère (plus qu’à son père) et revendiquer des droits pour garantir de bonnes conditions à l’exercice de la maternité. Plus largement, on va défendre l’idée que l’éthique du care est une propriété féminine (par exemple, dans les travaux de Hege Skjeie) et déplacer le combat du partage des tâches familiales sur le terrain de la reconnaissance et de la valorisation de ces tâches : que les femmes fassent le gros du boulot qui consiste à prendre soin des personnes ne serait un problème que dans la mesure où ce boulot est gratuit et invisibilisé.
Et si la lutte contre l’essentialisme participait à accroître certaines inégalités?
Certain-es vont aussi s’inquiéter des possibles effets contre-productifs de l’anti-essentialisme pour les droits des femmes.
La philosophe des sciences Peggy Sastre faisait paraître l’an passé un essai consacré au Sexe des maladies qui alertait précisément sur les risques d’une médecine indifférenciée.
Tandis qu’on poursuit les mythes universalistes et met au second plan ce qui différencie biologiquement les femmes et les hommes pour combattre ce qui les rend culturellement inégaux, la médecine, dit-elle, prend trop souvent les femmes pour des hommes : des médicaments testés sur des panels exclusivement masculins alors qu’ils peuvent ne pas convenir aux femmes, des affections typiquement féminines (du syndrome prémenstruel à l’endométriose) sous étudiées faut de crédit de recherche et sous-diagnostiquées faute de formation des médecins, des programmes de prévention inadaptés (qui ne tiennent par exemple pas compte des risques spécifiques du tabac ou de l’alcool pour les femmes)…
Etre ou ne pas être essentialiste, et si ce n’était pas la question ?
Choisis ton camp, camarade égalitaire?
Avec de mêmes intentions louables, celles de promouvoir l’égalité et de faire valoir les diversités, on a donc des visions de l’essentialisme qui s’opposent radicalement (et parfois très violemment, dans les mouvements féministes en particulier) : en appeler à « l’essence » est pour les un-es un piège absolu pour les femmes (parce que cela les confinerait dans des perceptions étriquées du féminin et des rôles traditionnels qui y sont assignés) et c’est pour les autres une voie privilégiée de la reconnaissance de ce qu’elles sont (en tant que telles, et non par rapport aux hommes).
Pour une restauration de la posture du doute critique
DescartesFaut-il pour autant choisir son camp ? Il semble que c’est dans le rapport que nous entretenons à la nature, à la biologie et à la science que la réponse se trouve.
Car on serait dans un symétrique aveuglement aussi bien en ayant foi en la nature et rien qu’en la nature (comme les naturalistes d’antan) qu’en cultivant la conviction que tout est culture et rien que culture. Dans les deux cas, on abolit le doute critique qui oblige à recevoir ce que l’on pense juste et vrai avec l’indispensable scrupule de prendre en considération une pensée différente ou contraire.
Pour rappel : le contraire d’égalité, ce n’est pas différence : c’est inégalité(s)!
Mais loin de nous l’intention d’engager chacun-e à la synthèse qui relativise tout et dilue les convictions : essentialiste ou anti-essentialiste, telle n’est finalement peut-être pas la question.
Et si la question c’était : comment traiter le différent, quelque soit la perception de sa différence qu’on se fait, comme son parfait égal dans tous les champs de l’existence ?
Car on le rappellera ici à toutes fins utiles : le contraire d’égalité, ce n’est pas différence, c’est inégalité ; le synonyme d’égalité, ce n’est pas indifférence, c’est équivalente considération pour ce qui ne présente de distinction ni de grandeur ni de qualité.
Marie Donzel, pour le blog EVE.





